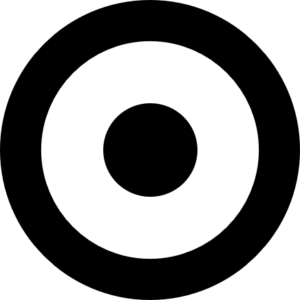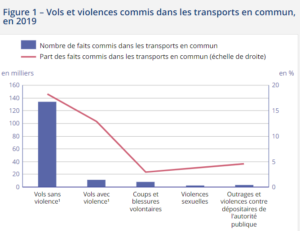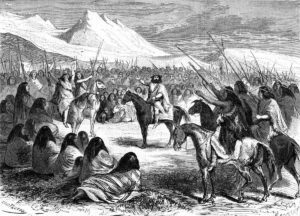L’auteur de ces pages ne se prend ni pour ni Marc Aurèle, ni pour un philosophe, quoique partagé entre stoïcisme et épicurisme. Après trente années passées comme dirigeant de structures dans les domaines sportifs, éducatifs et culturels, il livre ici, une série d’écrits, plutôt de notes, ayant servi à construire sa pensée, sa réflexion. Elles lui servirent aussi à mieux comprendre l’environnement dans lequel il évoluait afin de découvrir de nouvelles perspectives et de mieux anticiper l’avenir, car pour prévoir le futur, il vaut mieux connaître le passé. Plutôt que de ne rien faire de ces notes, il a décidé de les mettre à disposition de tous. Vous y trouverez aussi de nombreux articles sur un certain art de vivre et les histoires qui s’y rapportent, puisque « tout a une histoire ».
Bonne visite et bonne lecture !
Bienvenue sur le blog de RP2M
L’auteur de ces pages ne se prend ni pour ni Marc Aurèle, ni pour un philosophe, quoique partagé entre stoïcisme et épicurisme. Après trente années passées comme dirigeant de structures dans les domaines sportifs, éducatifs et culturels, il livre ici, une série d’écrits, plutôt de notes, ayant servi à construire sa pensée, sa réflexion. Elles lui servirent aussi à mieux comprendre l’environnement dans lequel il évoluait afin de découvrir de nouvelles perspectives et de mieux anticiper l’avenir, car pour prévoir le futur, il vaut mieux connaître le passé. Plutôt que de ne rien faire de ces notes, il a décidé de les mettre à disposition de tous. Vous y trouverez aussi de nombreux articles sur un certain art de vivre et les histoires qui s’y rapportent, puisque « tout a une histoire ».
Bonne visite et bonne lecture !